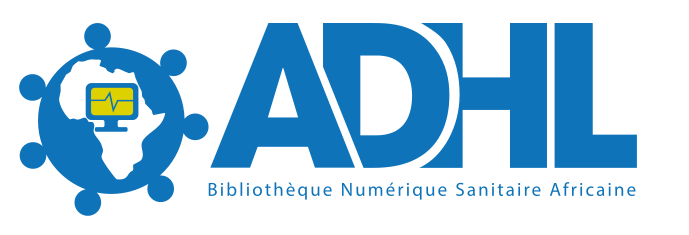Causes des méningites bactériennes chez les enfants d’un mois à 15 ans de 2012 à 2018 dans le service de pédiatrie de l’Hôpital du Mali
Abstract
Introduction : Les méningites bactériennes sont une des éventualités pathologiques les plus sévères et les plus redoutées en pathologie pédiatrique. L’objectif de cette étude est d’étudier les causes des méningites bactériennes dans le service de pédiatrie de l’Hôpital du Mali. Méthode : Il s’agit d’une étude analytique longitudinale rétrospective à visée prospective qui s’est déroulée de Janvier 2012 à Décembre 2018. Cette étude a porté sur 88 enfants répondant aux critères d’inclusion. Résultats : Nous avons observé une prédominance masculine (60,2%) soit un sexe ratio de 1,5. Les enfants de moins de 5 ans étaient les plus vulnérables (71,6%). Les enfants avaient reçu les vaccins contre Hib (72,7%), Pneumocoque (71,6%), Méningocoque (13,6%). Le tableau clinique associe l’obnubilation (68,2%), la convulsion (56,8%), le coma (56,8%) et la fièvre (80,6%). Sur le plan biologique, l’analyse du sang a révélé une hyperleucocytose (64,9%), une anémie (69,3%), la CRP était positive chez 83% des enfants. L’analyse du LCR prouve que la coloration gram était positive à (39,8%), le latex (29,5%), la culture (5,7%) et le PCR réel (40,9%). En ce qui concerne la bactériologie le Streptococcus pneumoniæ est le germe le plus fréquemment isolé avec 36,4 % des cas suivi de Neisseria meningitidis W135 (10,3%) des cas, Haemophilus influenzae b (5,7%) des cas et le Streptococcus agalactiæ B (4,5%), Haemophilus influenzae non b (3,4%), Neisseria meningitidis X (1,1%), Neisseria meningitidis C (1,1%) enfin Proteus mirabilis (1,1%). Sur le thérapeutique l’association du Ceftriaxone et de la gentamycine a été la plus utilisée avec 77.3%. L’évolution à court terme a été marquée par une guérison sans séquelle (64,8%), une guérison avec séquelles (12,5%) et un taux de létalité (18,2%). Conclusion : Toute modification du calendrier vaccinal, toute perspective d’arrivée de nouveaux vaccins transformeront encore l’épidémiologie et données cliniques des méningites dans les prochaines années. La poursuite de la surveillance apparait donc indispensable.