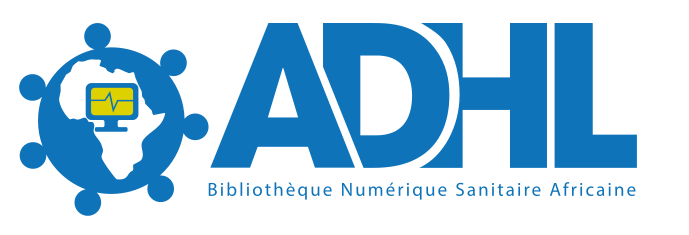Réhabilitation précoce après césarienne sous rachianesthésie: étude pilote menée a la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako
Résumé
Introduction :
Depuis quelques années le principe de réhabilitation précoce qui a été initialement développé en chirurgie digestive a vu son application se répandre en obstétrique. En effet, c’est en 1997, que Kehlet définit le concept de réhabilitation post opératoire comme étant une approche multidisciplinaire de la période post opératoire visant au rétablissement rapide des capacités physiques et psychiques antérieures d’un patient opéré. Pour cela, un accent a été mis sur l’importance de la technique anesthésique employée permettant de réduire la morbidité et la mortalité post opératoire. Évaluer l’apport des blocs de parois dans le programme de la réhabilitation rapide après une césarienne programmée ou en urgence relative sous rachianesthésie à la clinique périnatale Mohammed VI Méthodologie : Notre étude déroulée dans le service anesthésie et d’obstétrique de la clinique périnatale Mohamed VI et le centre hospitalier du district ( EPH-4 ) du 07 juillet 2022 au 31 juillet 2023 soit une période de 13 mois. Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive. La population d’étude était constituée de l’ensemble des parturientes opérées sous RA pour une césarienne pendant la période d’étude.
Résultats : Nous recruter un échantillon de 151 patientes. L'âge moyen des participantes était de 29 ans ± 5.61 ans avec des extrêmes de 17ans et 42 ans. Le statut professionnel le plus courant était celui des femmes au foyer, représentant 45% des participantes. L’indication opératoire était principalement maternelle, représentant 72,8 % des cas. Le terme moyen de grossesse était de 38,18 semaines d’aménorrhée. La majorité des parturientes étaient classées ASA 1, soit 66,9 % des cas. Une antibioprophylaxie a été systématiquement réalisée chez toutes les parturientes, avec l’amoxicilline choisie dans 57 % des cas. . Toutes ont reçu 8 mg d’ondansétron par voie sublinguale pour prévenir les nausées et vomissements postopératoires (NVPO), ainsi que 1 000 mg d’acide tranexamique en intraveineuse pour limiter les saignements. Pour le maintien du tonus utérin, l’ocytocine et le misoprostol étaient les molécules privilégiées. la rachianesthésie a été la technique anesthésique. La durée moyenne des interventions chirurgicales était de 43,37 minutes avec une perte sanguine estimée en moyenne à 260,26 ml. Cent de nos parturientes ont bénéficié d’un bloc de paroi, répartis entre 52 TAP et 48 QLB . Les patientes sans bloc de paroi présentaient un seuil douloureux plus élevé, que ce soit au repos ou à la mobilisation. Un antalgique intraveineux a été nécessaire chez 49 patientes, soit 32,4 %. Le recours à ces traitements était plus fréquent dans le groupe sans bloc de paroi (59,2 %) que dans les groupes TAP (28,6 %) et QLB (12,2 %). La sonde urinaire a été retirée à H2 chez la majorité des patientes. La déambulation a été initiée à H6 de manière systématique. Des incidents postopératoires immédiats ont été observés chez 53,7 % des patientes, principalement des nausées et vomissements postopératoires (NVPO) (18,6 %), suivis de prurits (15,2 %), de céphalées et cervicalgies (9,3 %). Les NVPO ont été traités par l’injection de 4 mg d’ondansétron à chaque épisode, en complément de la prévention par voie orale. La durée moyenne d’hospitalisation a été de 53,11. La satisfaction des patientes était excellente dans 100 % des cas pour les groupes TAP et QLB.